
Dombré de ciriques à 10€ ! la liste des restaurants participants !
Vendredi 28 juin MILO’S 6 Rue du commandant Varasse 0596.68.55.08 Vendredi 28 et Samedi 29 juin LE TAPIS VERT 23 Rue du
Evénements passés et futurs
Evénements passés et futurs
Seulement les événements passés
Seulement les événement futurs
Type d'événement:
Tout
Tout
Accompagnement numérique
Aides
Ateliers
Bal populaire
Causerie – Débat
Chant
Chanté Nwel
Cinéma
Cirque
Concert
Concert musique classique
concours de dessin
Conférence
Conte
Danse
Débat
Défilé
Défilé de mode
Exposition
Fête de la famille
Fête de quartier
Fête patronale
Gastronomie
Ikebana
Loisirs
Marché
Musique
Permanence
Projection
Rallye
Randonnée
Récital
Rencontre littéraire
Réunion d’information
Services
Spectacle de danse
Sport After Work
Sports
Théâtre
Twadisyon pou ti moun
Vernissage
VTT
Wouspel Mizik
Pas d’événement prévu

Vendredi 28 juin MILO’S 6 Rue du commandant Varasse 0596.68.55.08 Vendredi 28 et Samedi 29 juin LE TAPIS VERT 23 Rue du

Le rallye a lieu samedi 29 juin de 7h à 13h à Rivière-Salée. Les inscriptions sont terminées, merci pour votre massive participation

Tu as des projets ? Viens donner ta vision. Viens montrer ton énergie. Nous recherchons plusieurs jeunes de 16 à 25 ans,

Inscrivez-vous pour le rallye découverte ! Découvrez la commune en vous amusant et en brûlant des calories ! Les participants devront trouver grâce à

Rivière-Salée aime la musique ! C’est pourquoi, amis musiciens, nous vous proposons cette année de jouer à la fête de la musique

Cette semaine vous avez plusieurs beaux rendez-vous ! La fête de la famille.Comme chaque année, les mères et pères méritants sont mis
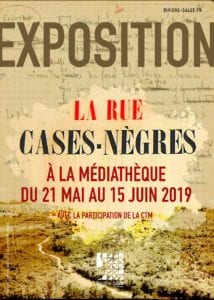
Exposition du 21 mardi au samedi 15 juin La rue Case- nègres Avec la participation de la CTM Médiathèque
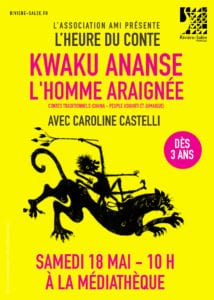
Deux rendez-vous à ne pas rater cette semaine VENDREDI 17 MAI : Théâtre au centre culturel « ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE
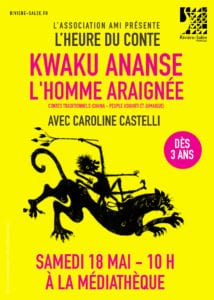
Heure du conteL’Association AMI vous présente « Kwaku ananse l’homme araignée » Les histoires voyagent grâce aux bouches à oreilles. En Jamaique, on raconte

Un conte pour les tout-petits, un atelier pour préparer un cadeau pour maman, une causerie débat et une expo. Mai à Rivière-Salée.
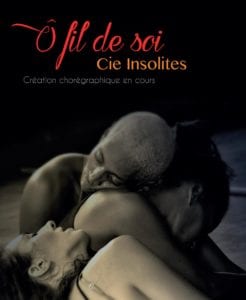
La compagnie a été créée en 2016 à l’occasion de la première création chorégraphique « Ô fil de soi » de la

Les images d’archives de Rivière-Salée, colorisées. Comment consulter les archives de la ville ? Les usines de Rivière-Salée

Nous avons entrepris de rendre leurs couleurs originales aux images d’archives de Rivière-Salée. A partager. Le procédé Le résultat Voir aussi

« Les LUMINAS, les grands trophées de la jeunesse « récompensent tous les deux ans les jeunes les plus talentueux de la Martinique, peu

Dans le cadre de la journée internationale de la femme.La ville de Rivière-Salée et Nicole Cage Florentiny presentent : Si telman famn

Séance de partage volée par les caméras de Martinique la 1ère. Roro Kaliko sera sur la scène pour la Silver Parade de

La grand-robe… symbole de nos traditions. Combien de façon de la porter ? Petite capsule vidéo à partager.

Rendez-vous le 23 février à 14 H au Stade de Trenelle pour le grand départ de tous les groupes ! Venez avec
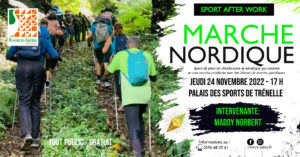
La ville de Rivière-Salée vous donne rendez-vous pour le 2ème « SPORT AFTER WORK ». En collaboration avec Madame Maddy Norbert, enseignante en Activités




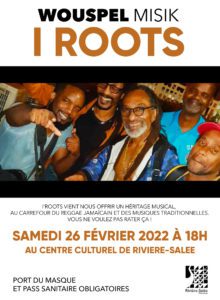
I’Roots vient nous offrir un héritage musical, au carrefour du reggae jamaïcain et des musiques traditionnelles. Vous ne voulez pas rater ça